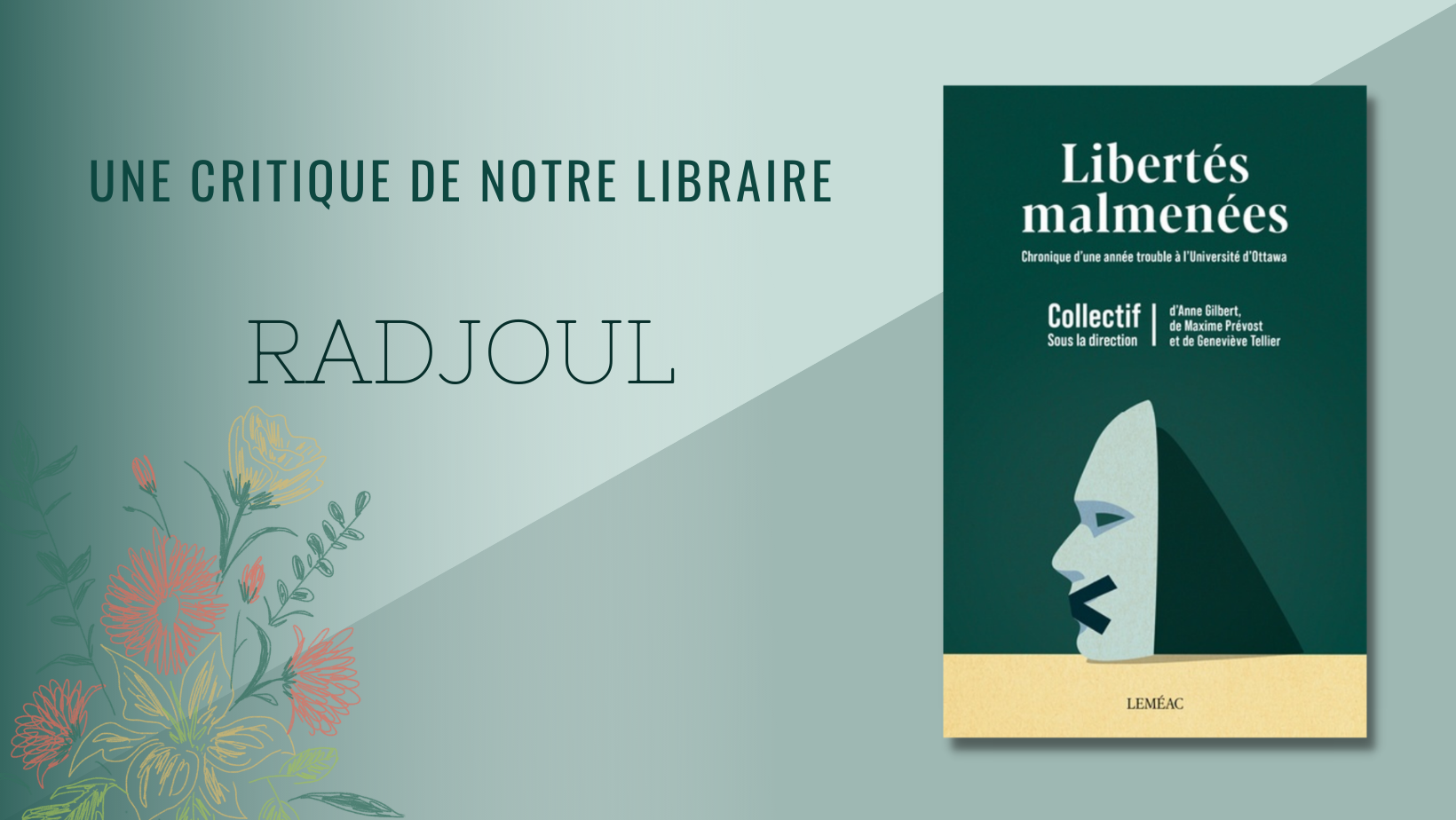
Libertés malmenées
Notre libraire Radjoul vous offre ci-bas sa critique de l’essai collectif Libertés malmenées.
——————————————————————————————————————–
Le cahier de charge du collectif d’universitaires ayant collaboré à Libertés malmenées (Leméac, 2022) était simple : « établir un diagnostic », c’est-à-dire réfléchir et analyser, « par-delà la sidération et la dénonciation », la « crise d’octobre » (p. 25) qui a secoué l’Université d’Ottawa en 2021. Il s’agissait, pour Yves Gingras, auteur d’une préface tout en altitude qui insiste sur « La mission oubliée de l’université »
(p. 7-22), de « ne pas se contenter d’énoncer son vécu, mais aussi de l’objectiver et, pour cela, de prendre la distance nécessaire à toute tentative de compréhension rationnelle d’une situation dans laquelle on est soi-même immergé. » (p. 9) De la tribune à l’ouvrage collectif, de Libertés surveillées à Libertés malmenées, il fallait donc monter d’un cran dans l’analyse. Pari réussi ? Partiellement.
Face à cette crise qui épouse tous les traits d’une « panique morale » (p. 209), il fallait de la hauteur de vue. Disons-le une bonne fois pour toutes : dans l’absolu, l’université doit demeurer un sanctuaire imperméable aux (auto)censures et pressions d’où qu’elles viennent. Cela suppose de ne pas lâcher d’un pouce la défense des libertés académiques et redire que le traitement réservé à Verushka Lieutenant-Daval est inacceptable. À cet égard, Libertés malmenées apporte une clarification salutaire du différend, non sans que les contributeurs ne s’autorisent à marteler leurs positions dans ce qu’ils confinent à une guerre de tranchées. La « guerre idéologique » en cours, opérant par la « militarisation des plateformes numériques » (p. 231), déborde largement le cadre restreint des libertés académiques, car elle révèle les mutations affectant le débat public et un déplacement du seuil d’intolérance aux inégalités (réelles ou perçues) dans nos démocraties. Sur ces enjeux cruciaux, s’il faut se fier à la polarisation stérile proposée, nous avons affaire à des apologues de la bonne vieille rationalité, rassemblés sous la bannière du camp de la Raison, contre de dangereux tartuffes, adeptes d’un « fanatisme dogmatique » (p. 350), se réclamant eux du camp du Bien. Cet acharnement à s’attribuer le « beau rôle » à l’exclusion de l’adversaire va agacer plus d’un lecteur. Aucun échange rationnel n’étant possible sans un accord minimal sur quelques principes. Le campisme inhérent à la logique agonistique de laquelle procède cette opposition binaire caricaturalement présentée comme irréconciliable laisse peu de place à la dialectique et au compromis, exacerbant les tensions et nuisant gravement à l’émergence d’un horizon commun.
Et pour cause, ce genre de dilemmes éthiques n’est pas réductible à un jeu à somme nulle. Bien que certains contributeurs s’en défendront à bon droit, d’autres s’installent trop confortablement dans le registre de l’adversatif : communautaristes anglo-saxons vs universalistes francophones, woke vs anti-woke, militants vs sachants, émotions vs Raison, arguments vs slogans, etc. D’aucuns flirtent même avec la caricature. François Charbonneau, par exemple, voulant rendre auxdits « universiataires woke » la monnaie de leur pièce, se livre à un déboulonnage symbolique des plus irrévérencieux. Pour lui, Michel Foucault, « un des maîtres à penser de la mouvance [woke]», serait « un homme qui a mis son indéniable génie et sa maestria au service de quelque chose qui s’apparente chaque fois à une théorie du complot » (p. 122). C’est de bonne guerre : tant qu’à déconstruire les déconstructeurs des institutions autant commencer par Foucault ! Au surplus, le professeur agrégé à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa soutient que les « constructivistes », les « penseurs décoloniaux » et les « universitaires woke », qui « carburent à la théorie critique de la race » (p. 121) professeraient une « construction sociale oppressive » (p. 140) ne se distinguant en rien de celles qui l’ont procédées. Une telle critique ne résiste quoique retorse ne résiste pourtant pas à l’épreuve du réel, car la toute-puissante « théorie critique de la race » a été bannie en catimini dans plus d’une dizaine d’États américains. Des cas flagrants de libertés académiques malmenées par le pouvoir politique. En effet, des projets de loi ont été adoptés dans quelques États à majorité républicaine aux États-Unis, dont le Tennessee, l’Oklahoma, l’Idaho et le Texas, pour endiguer l’influence des fameuses « critical race theory », en totale violation du Premier amendement de la Constitution américaine qui, comble de l’ironie, garantit la liberté d’expression même aux groupes néo-nazis et autres suprémacistes blancs. Dans le meilleur des mondes des anti-woke, les discriminations systémiques dénoncées ne sont-elles pas une pure vue de l’esprit ? Pendant ce temps, Matthew Hawn, enseignant titulaire au Sullivan County School District dans le Tennessee depuis 2008, a été licencié en 2021 pour avoir enseigné un essai de Ta-Nehisi Coates, « The First White President », à ses étudiants. Circulez, il n’y a rien à voir ! Les libertés académiques, faut-il encore le rappeler, sont absolues ou elles ne sont pas !
Parallèlement, Geneviève Tellier fustige la « gouvernance woke universitaire » (p. 262) importée des États-Unis qui invite à « incorporer une nouvelle grammaire de l’antiracisme » (p. 264) inspirée des initiatives EDI (équité, diversité, inclusion), empêchant tout dialogue et contraignant chacun « à jouer le rôle de sa race » (p. 263) sur la grande scène de théâtre professionnelle. Autant il est souhaitable de fustiger toutes les formes d’assignations identitaires autant on a du mal à voir poindre une alternative concrète à la poursuite d’une politique de discrimination positive. Selon Sylvie Paquerot, la provenance américaine et l’inefficacité présumée disqualifient cet incitatif de lutte contre les discriminations : « l’EDI n’apparaît pas comme une doctrine très pertinente pour faire reculer la discrimination en contexte canadien, elle représente aussi un risque important pour la liberté universitaire à un niveau » (p. 346). Que faire ? Faut-il pour autant laisser faire la main invisible du marché de l’emploi universitaire qui, à force de biais cognitifs et de préjugés racistes ou sexistes plus ou moins assumés, favorise fatalement un certain darwinisme social sous prétexte d’efficacité, d’objectivité, et de méritocratie ?
Pour élargir la réflexion, il m’apparaît périlleux de convoquer une « panique morale » en défense de la liberté académique, pour balayer d’un revers de la main tout l’arsenal théorique et institutionnel de lutte contre les discriminations (EDI, approches postcoloniales, critiques de la race et des discriminations). Tout cela avec une certaine désinvolture, sans même daigner faire montre de « tolérance des points de vue divergents » (p. 23) ni traiter de l’innommable (« mot en N »). Ce lapsus révélateur du malaise de l’université et au-delà. Étonnamment, c’est Verushka Lieutenant-Daval, celle par qui la « crise » est arrivée, qui finalement pointe du doigt l’éléphant dans la pièce : « Aujourd’hui, c’est le « mot en N », peut-être demain, ce sera le « mot en I », puis peut-être même le mot femme, qui sait ? » (p. 110). Pourquoi cette figure archaïque du « Nègre » est-elle devenue l’enjeu d’une guerre idéologique qui menace la liberté académique ? Cette question aurait mérité un traitement plus approfondi, bien plus que cette pathétique mise en scène d’une lutte de places entre camps opposésdans le champ académique, par l’instrumentalisation de la question de la sous-représentation des minorités. Depuis son apparition sur la grande scène de l’Histoire, il n’a cessé d’être une écharde dans le langage, un trouble dans la figuration et un intarissable puits à fantasmes. Le substantif « Nègre » ne renvoie certes plus à une vacuité d’être à combler, mais continue de susciter un trouble dans le dire et de cristalliser des éruptions passionnelles. Avec sa charge radioactive de clichés et de fantasmagorie, il est demeuré un péril pour la Raison, l’Égalité, la Justice, etc. D’empreinte déshumanisante accolée à l’humanité tout entière comme une « peau de race » à son « détournement subversif », le glissement contemporain de « Nègre » à « mot en N » traduit le passage de l’expérience primordiale de la négation imposée à l’humanité africaine à un nouveau régime de l’innommable. Le mot nègre – devenu «mot en N » – déforme et précipite la langue dans le gouffre où furent jadis enfermé ledit homme noir. Dans Critique de la raison nègre (2013), Achille Mbembé nous prévenait que depuis l’invention de la figure « Nègre » par l’Europe coloniale, elle n’a jamais cessé revêtir le signe d’une altérité impossible à assimiler. Alors que certains s’échinent à la réduire à un statut de relique dévitalisée d’un passé inglorieux, il semblerait qu’elle métastase désormais le langage. Dans le malaise contemporain de l’université, le mot Nègre indique le point extrême où la disjonction entre le mot, la chose et sa représentation s’opère. L’expérience limite où la Raison perd la tête et le langage. De quoi le mot « nègre » est-il encore le symptôme ? Voilà peut-être la plaie béante que la crise survenue à l’université d’Ottawa en octobre 2021 a rouverte. Il n’est pas sûr qu’elle cicatrisera, si nous nous gardons soigneusement de ne pas plonger la plume dans la plaie.
Radjoul Mouhamadou
Categories:
Avis, Essais, Les chroniques de Radjoul, Sans classement, Suggestions de lecture, Vos libraires
